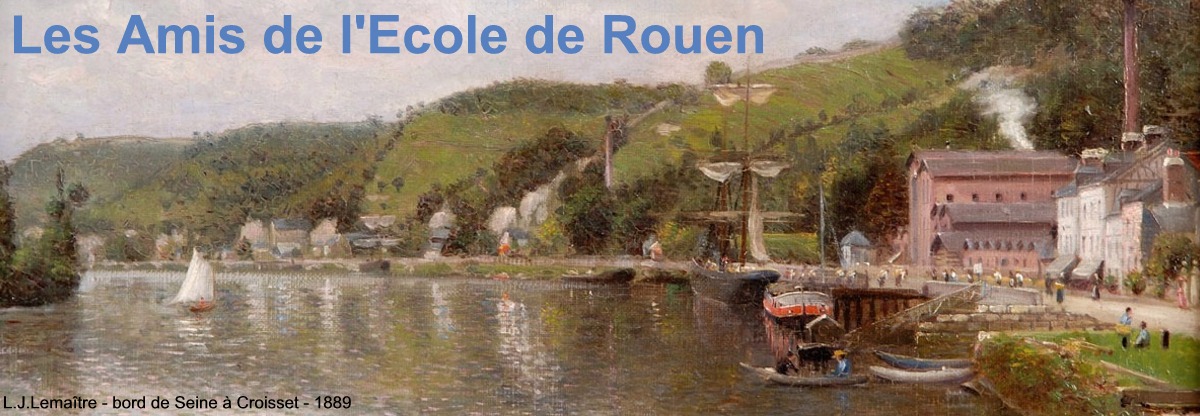Interview de Diederik BAKHUYS
Nous avons rencontré
pour vous, le vendredi 25 novembre 2011, dans son antre du Cabinet des dessins,
Diederik BAKHUŸS, absorbé par de
nombreux projets pour les années 2012-2013 : plusieurs expositions
organisées pour octobre 2012, Nicolas COLOMBEL pour
novembre, une grande exposition de dessins français du XVIIIe pour
2013-2014, alors que se profile pour le printemps et l’été 2013 la prochaine
édition de Normandie impressionniste.
Formé en histoire de
l’art à l’Université de PARIS-I,
Diederik BAKHUŸS est
recruté en 1997 par Claude PÉTRY,
alors directrice des musées de ROUEN.
Choisi en raison de sa spécialité « dessins », il est chargé du
cabinet d’arts graphiques du musée. Rappelons que ce dernier abrite quelques
10.000 pièces et compte parmi les plus prestigieux de France.
Pierre BUYCHAUT : vous
êtes arrivé juste un an après l’exposition L’École de ROUEN, de l’impressionnisme à Marcel DUCHAMP...
Diederik BAKHUŸS : Oui, et
c’est en feuilletant le catalogue que j’ai découvert l’École de ROUEN dont, je dois l’avouer,
je ne connaissais même pas l’existence avant d’arriver… Et puis après par les
salles DEPEAUX, qui n’étaient pas
ce qu’elles sont aujourd’hui. J’ai été surpris, intrigué, mais je n’ai pas
approfondi la question avant des années. J’étais alors accoutumé à travailler
sur le dessin ancien, moins attiré sans doute que je ne le suis aujourd’hui par
l’art de cette période.
J’avais été frappé,
pourtant, par un dessin de Charles FRECHON représentant
l’intérieur de l’Église St Vincent, une grande feuille offerte au musée en 2000
par Mlle MOUCHELET.

Charles FRECHON - Eglise St Vincent
PB : cette
feuille était, d’ailleurs, de nouveau présente à sa rétrospective de 2008.
DB : Oui, et
ma vraie plongée dans l’École de ROUEN date,
en fait, de cette rétrospective Charles FRECHON, qui a été une très belle expérience et l’occasion
pour moi d’une vraie découverte. J’aime tout particulièrement les toiles des
années 1890-1895, avec leurs jardins et leurs vergers saturés d’éclats de
lumière, leur côté très dense, très « rempli ». Mais même la fin de
sa carrière, qui a moins bonne réputation, réserve parfois de belles surprises
avec des toiles empreintes d’une grande poésie. L’exposition m’a révélé par
ailleurs un dessinateur vraiment extraordinaire, qui explore des domaines
entièrement différents de ceux du peintre, ce que je trouve toujours
particulièrement intéressant. Je peux vous avouer que je suis beaucoup plus
sensible à un dessin en touches croisées de Charles FRECHON qu’à une aquarelle de Paul SIGNAC, par exemple. Charles ANGRAND aussi me semble bien
supérieur à ce dernier comme dessinateur, notamment dans ses Maternités qui
sont des merveilles.
PB : Cette
rétro fut le résultat de la collaboration de notre Association avec votre
musée…
DB : C’était
le cas typique d’un sujet dont les amateurs s’étaient emparés avant que les
musées ne s’y intéressent. Votre association a tout d’abord joué un rôle fort
utile d’aiguillon. Elle a été une force d’impulsion. Elle nous a ensuite
énormément aidés en nous donnant accès à des collections privées. Nous avons eu
la chance aussi de bénéficier de l’immense savoir accumulé par François LESPINASSE. Que saurions-nous du sujet,
s’il n’avait pas collecté une masse d’informations dispersées, s’il n’avait pas
retracé la succession des expositions anciennes, pisté les œuvres, visité les
collections ? Presque rien… Vous ne vous en rendez pas compte, mais
pouvoir accéder d’un coup à un milieu de collectionneurs passionnés et
extrêmement bien informés sur le sujet est loin d’être courant lorsque l’on se
lance dans un projet d’exposition. C’était d’autant plus nécessaire que
beaucoup de FRECHON majeurs
sont encore conservés en mains privées.
PB : et pour Normandie
Impressionniste 2010 ?
DB :
La relation nouée à l’occasion de cette rétrospective a trouvé un prolongement
formidable au moment de la grande exposition impressionniste de l’été 2010.
L’une des missions d’un musée comme le nôtre est de faire alterner des
expositions « grand public », avec des signatures prestigieuses, et
d’autres moins faciles, voire tout à fait en dehors de « l’air du temps »,
comme Mère Geneviève GALLOIS (1888-1962).
Le Génie et le voile en 2004, dont j’ai adoré m’occuper. La
rétrospective FRECHON était
bien sûr moins risquée, mais Laurent SALOMÉ et
moi-même tenions à traiter le sujet de façon ambitieuse. L’artiste ne doit pas
être vu uniquement comme un « peintre local » puisque son
parcours rejoint à certains moments la grande histoire des avant-gardes. Il a
pratiqué une forme de néo-impressionnisme très tôt, avant même d’inventer sa
propre vision de l’impressionnisme. Le fait d’avoir été « néo » avant
même d’être vraiment impressionniste est une particularité étonnante. Jamais la
« grande » histoire de l’art n’avait effleuré ces questions…
L’exposition Une Ville pour l’impressionnisme en 2010 a permis
d’insister là-dessus, en rappelant plus généralement que les
« mousquetaires » de l’École de ROUEN ne
proposaient pas une interprétation a posteriori des recherches
de l’avant-garde parisienne, mais travaillaient précisément au même moment. Le
parcours même de l’exposition, vous vous en souvenez, rendait sensible ce
constat.
PB : Pierre DUMONT ?
DB : ah, je vous vois venir (rire) ! Oui, le musée a acquis l’été dernier une très étonnante gouache pointilliste de cet artiste : une grande feuille qui représente l’abbatiale Saint-Ouen, formée d’une multitude de petites taches appliquées à la pointe du pinceau. Par bonheur l’œuvre est signée !
 |
| Pierre DUMONT - Abbatiale de Saint-Ouen - mbar |
Car, par la minutie de la
technique et la douceur des dégradés, elle diffère entièrement de ce que l’on
connaît du peintre. Sans doute faut-il la placer très tôt, au début du XXe siècle,
alors que le jeune artiste cherche sa voie en revenant sur les expériences du
néo-impressionnisme.
Entre ANGRAND et FRECHON, il y a eu une vraie tradition
d’expérimentations graphiques dans le milieu rouennais. C’est intéressant et
tout à fait inattendu de voir qu’elle s’est prolongée chez un artiste comme Dumont.
PB : y a-t-il
un peintre de l’Ecole de Rouen qui vous tienne plus particulièrement à cœur ?
DB : en
fait deux, et même trois, avec Charles FRECHON depuis
sa rétrospective. Charles ANGRAND arrive
en tête ! Il y a l’œuvre, restreint mais passionnant, et il y a le
personnage, si sensible, si honnête, si attachant dans sa fragilité !
C’est un être intelligent, qui porte sur le travail de ses contemporains des
jugements d’une finesse merveilleuse. Il faut absolument lire son
extraordinaire correspondance publiée par François LESPINASSE.
Et puis le
Robert-Antoine PINCHON des
débuts ! Celui d’avant 1914, comme on l’a vu dans l’exposition
impressionniste de l’été 2010 ! Mais c’est un artiste dont l’image peut
souffrir du principe de la rétrospective, qui embrasse l’ensemble d’une
carrière. C’est ce qui rend problématique, sans doute, l’idée d’une grande
exposition au musée. Il n’est pas simple d’expliquer au public que l’on préfère
écarter les œuvres tardives. Je trouve moins palpitant en revanche, je dois l’avouer,
l’œuvre d’Albert Lebourg, pourtant bien représenté au musée.
PB : d’où
vient, d’après vous, que cette « École » manque de reconnaissance
aujourd’hui ?
DB :
vaste question… Il y a d’abord des raisons historiques. Les figures marquantes
que l’on range sous cette bannière n’ont pas eu des parcours faciles. Ils ont
eu des difficultés (c’est même un euphémisme) à s’imposer auprès des
collectionneurs parisiens. Et le milieu rouennais a beaucoup tardé à leur faire
une place, en dépit du soutien de François DEPEAUX ou de Georges DUBOSC. Je pense d’ailleurs que l’histoire aurait été
différente si DEPEAUX avait
soutenu ANGRAND ou même
le FRECHON néo-impressionniste,
plutôt que de favoriser DELATTRE ou LEBOURG. Ce collectionneur n’a jamais
vraiment adhéré à l’expérience pointilliste. Curieusement, le plus bel ensemble
de FRECHON conservé
dans un musée n’est pas accroché dans nos salles DEPEAUX : il est à LOUVIERS ! Et l’on arrive à ce résultat bizarre : FRECHON, qui exposait chez DURAND-RUEL à PARIS à une époque où il ne
vendait rien à ROUEN, est
aujourd’hui presque inconnu en dehors de la région… alors qu’il nous manque au
musée un ou deux tableaux vraiment marquants pour lui rendre tout à fait
justice. Une rétrospective permet de faire avancer les choses, mais pas autant
que l’on aimerait : il y a une telle pléthore d’évènements à PARIS que l’on peine à convaincre
le public parisien, les critiques, le milieu des collègues de la capitale, à
venir voir une exposition consacrée à un personnage dont ils ignorent tout.
Il y a selon moi une
autre difficulté dont je parlerai très franchement. La dénomination
« École de ROUEN » est
sans doute commode mais elle pose aussi des problèmes… En voulant rattacher
plusieurs générations de paysagistes rouennais au train de l’impressionnisme,
on en a desservi certains. Il me semble qu’une association comme la vôtre doit
débattre de la question.
PB : expliquez-vous…
DB :
eh bien, l’École de ROUEN correspond-elle
à un mouvement, à un milieu homogène ? Personne ne peut le
prétendre. ANGRAND a
été un acteur central du mouvement néo-impressionniste. Ce n’est pas un peintre
local, même s’il a vécu et travaillé à ROUEN.
N’est-il pas abusif, par
ailleurs, de ranger sous la même bannière des artistes de la génération
de LEMAÎTRE ou de FRECHON – ces
« mousquetaires » qui, à certains moments, ont été
« synchrones » avec ce qui se faisait à PARIS – et des épigones de la 2e ou 3e génération ?
C’est pour l’histoire de l’art un milieu bien trop disparate !
On trouve d’ailleurs
parmi ses représentants tardifs de cette curieuse « École » des
figures sensibles et attachantes. Elles ont tenu une place sur la scène locale
et cela mérite tout notre respect. Mais elles étaient déconnectées des
avant-gardes de leur époque, ou bien y réagissaient d’une façon superficielle.
Cela fausse le regard porté sur les créateurs les plus marquants, qui souffrent
fatalement d’être mis dans le même sac que des
artistes de troisième ordre. On peut parfaitement éprouver de la sympathie pour
des peintres qui suivent leur voie sans se préoccuper d’être à la pointe de
l’avant-garde. Cela m’arrive tous les jours. Mais rend-on vraiment service à
Narcisse GUILBERT ou à
Narcisse HÉNOCQUE, par
exemple (2e génération NLR), en les présentant comme les
héritiers des « mousquetaires » ?
Ceci étant dit, j’admets
volontiers que ce concept, tout bancal qu’il soit selon moi, a permis de créer
un intérêt autour du milieu rouennais et c’était plus que nécessaire. Il a
servi de fil conducteur aux travaux de François LESPINASSE et ce qu’on doit à ses recherches est
proprement sidérant. J’en parlais à propos de FRECHON, mais cela vaut pour bien d’autres. Sans lui, combien
de peintres qui sont aujourd’hui parfaitement documentés seraient tout
simplement des inconnus… Et tant mieux également si des artistes ignorés en
dehors de la région parviennent aujourd’hui, grâce notamment aux efforts de
votre association, à toucher parfois un public plus lointain.
PB : et
Normandie impressionniste 2013 ?
DB : comme
vous le savez, l’exposition de ROUEN portera
sur la question des reflets dans l’eau, qui est consubstantielle de l’histoire
de l’impressionnisme. Nous ne traiterons pas de la question du reflet dans le
miroir, qui est un magnifique sujet en soi, mais qui obéit à d’autres
problématiques. Nous remonterons aux sources de la question en revenant sur
l’œuvre de précurseurs comme TURNER, COROT ou DAUBIGNY. Les Nymphéas de MONET occuperont dans l’exposition
une place comparable à celle que tenaient les Cathédrales en
2010.
Le propos ne sera pas
topographique, mais Sylvain AMIC (successeur
de Laurent SALOMÉ à la
tête des musées de ROUEN depuis
octobre 2011 - NDLR) insiste à juste titre pour que le motif de la SEINE soit fortement présent. Vous
savez la place extraordinaire que le fleuve a tenue dans la peinture
impressionniste.
PB : y
verra-t-on des représentants de l’Ecole de Rouen ?
DB :
Il y a sans doute moins de raisons objectives qu’en 2010 d’inclure un très
grand nombre d’œuvres de l’École de ROUEN :
la ville était alors au cœur du sujet. Mais elles seront assurément présentes.
Nous sommes vraiment persuadés de la nécessité de rappeler sans cesse
l’existence d’un milieu impressionniste proprement rouennais. Ceci étant dit,
je suis aujourd’hui accaparé par d’autres projets et c’est Sylvain AMIC, qui connaît la peinture de cette
période sur le bout des doigts, qui a repris le sujet. Je reviendrai en renfort
plus tard.
PB : quels
sont vos projets personnels ?
DB :
Je travaille en ce moment sur Nicolas COLOMBEL,
né à SOTTEVILLE-LES-ROUEN autour
de 1644 et mort à PARIS en
1717. On connaît de lui environ 75 tableaux. Nous espérons en réunir la
moitié.
Nous travaillons
également sur une formule passionnante intitulée Le Temps des
collections. Il s’agit de proposer, un peu comme nous l’avons fait pour Gérard DAVID en présentant la
restauration de la Vierge entre les Vierges, un éclairage ponctuel
sur une peinture ou un artiste. En juxtaposant chaque année une dizaine
d’évènements de ce type dans les trois musées entre octobre et mai, nous
renouvellerons en fait toute la perception des collections permanentes.
Un Bulletin des
musées de ROUEN permettra
de publier les résultats des recherches faites à cette occasion.

Nicolas COLOMBEL - le Christ et la femme adultère - Musée des Beaux-arts de Rouen
propos recueillis par Pierre BUYCHAUT