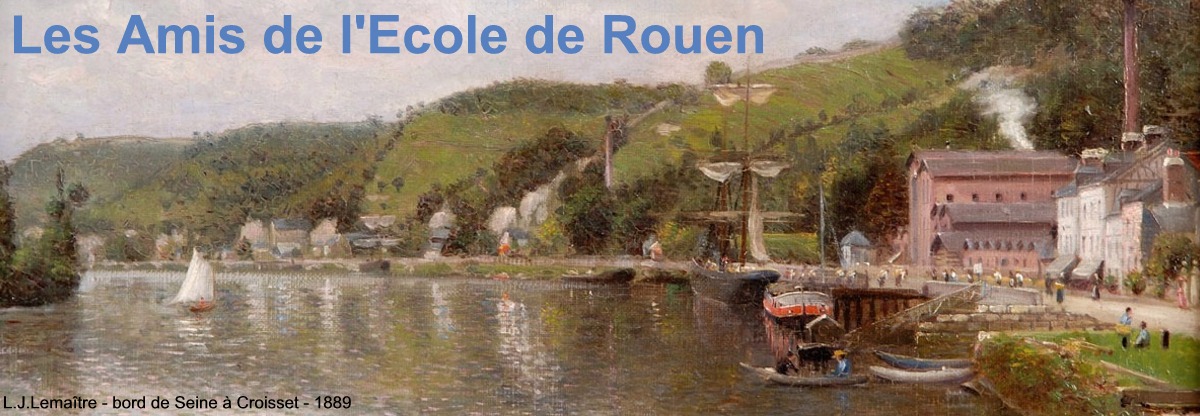Interview de Christophe DUVIVIER
C'est au cours de son
exposition sur L'arbre dans la peinture de paysage,
entre 1850 et 1920, de Corot à Matisse, que nous
rencontrons Christophe DUVIVIER au Musée Tavet-Delacour.
A la tête des Musées de
Pontoise depuis 1990, il a assuré le commissariat ou collaboré à la réalisation
d'une centaine d'expositions en France mais aussi à l'étranger (Japon, Italie,
Allemagne, Pologne...) dédiées à l'art des XIX et XXème siècles, de
l'Impressionnisme à l'Art Concret et Contemporain.
Pierre BUYCHAUT: vous avez intégré
ANGRAND, FRECHON et PINCHON dans votre Exposition sur l'Arbre. Vous connaissez
donc L'École de Rouen ?
Christophe DUVIVIER : oui, j'allais dire « depuis toujours »
car, je dois l'avouer, je suis « un peu » normand et j'ajouterai pour
appuyer ce clin d'œil à la Normandie que le Musée Tavet-Delacour est installé
dans un grand vicariat qui dépendait de Rouen, un bel hôtel particulier de la
fin du XVème siècle construit à
l'initiative de Guillaume d'Estouteville...
Plus sérieusement, j'ai
assuré le commissariat d'une exposition dédiée au Néo-impressionnisme au Japon
en 2002, pour laquelle François Lespinasse m'avait apporté son aide.
Mais qui évoque
l'Impressionnisme pense immédiatement à la Normandie. Il faut
savoir aussi que la Normandie a contribué à l'aventure
Néo-impressionniste, non seulement en donnant quelques motifs à Georges Seurat
mais aussi, évidemment, en donnant au mouvement une figure importante : Charles
Angrand.
Il ne faudrait pas
oublier non plus la présence de Camille Pissarro à Eragny-sur-Epte dans les
années décisives de ce même mouvement.
P.B. : ce qui explique votre rétrospective Charles
Angrand en 2006 au Musée Tavet-Delacour.
C.D. : effectivement, je me suis intéressé à Charles
Angrand à travers le Néo-impressionnisme mais je m'intéresse aussi à des
peintres post-impressionnistes comme Albert Lebourg ou Charles Frechon.
J'ai aussi consacré une
exposition aux peintres Néo et post-impressionnistes anglais autour de Lucien
Pissarro, exposition reprise par le Musée de Dieppe car elle faisait une place
importante aux vues de Dieppe par Walter Sickert, Spencer Gore ou encore Harold
Gilman. Mais je parle ici de Normands d'outre-manche !
PB : l'École de
Rouen ?
C.D. : ce terme d'« ECOLE » est quelque
peu gênant. Les Impressionnistes furent les premiers à rejeter cette
terminologie avec raison. Ils étaient contre l'École avec un grand
« É ». Ce sont des étiquettes données après coup qui ne veulent pas
dire grand-chose d'un point de vue historique ou esthétique. Comme la plupart
de ces dénominations, c'est une création a posteriori du marché de l'art qui a
convergé vers des préoccupations régionalistes ou éditoriales. La fortune de
l'« École de Barbizon » est à ce titre exemplaire. Remarquez qu'avec
le temps, ce type d'usage « contamine » les
historiens de l'art et finit par s'imposer durablement par commodité.
Mais, heureusement, on ne
parle pas encore d' « École Impressionniste », ni même d'
« École Néo-impressionniste » ce qui serait au demeurant de l'ordre
du pléonasme. Nous sommes à l'aube du XXème siècle et c'est
bien la notion de mouvements qui doit désormais prédominer, les fameux
« ismes ».
Toutefois, l'aspect
positif de cette terminologie réside dans le fait qu'elle permet l'étude d'un contexte
local dans sa complexité et le traitement de l'histoire de l'art en ne se
limitant pas aux figures majeures. Ainsi, des artistes injustement oubliés,
font l'objet d'études et d'un légitime regain d'intérêt de la part des
collectionneurs.
P.B. : mais le grand journaliste et critique d'art au Figaro,
Arsène Alexandre, avait employé ce terme en 1902 dans un article sur ces
peintres Rouennais, comme d'autres avant lui, il faut le dire. Alors, comment
les nommeriez-vous?
C.D. : « GROUPE » ! Je
m'explique : quand il s'agit de l'art indépendant, c'est-à-dire
l'essentiel de la peinture de paysage au XIXème siècle, je
préfère, en effet, parler de « groupe » au sein des mouvements, tel
celui de Pontoise formé par Cézanne, Guillaumin et Béliard autour de Pissarro.
La notion de « groupe » montre bien qu'il y a des liens d'émulation,
d'amitiés intellectuelles, d'influences et de combats entre des peintres et
cela à un moment précis. C'est ce moment précis de convergence des recherches
qui prévaut sur une appartenance géographique même s'il est souvent lié à un
lieu. Notons que c'est d'ailleurs le cas dans les relations qui unirent Angrand
et Frechon.
P.B. : parlez-nous de votre choix de Angrand, Frechon et
Pinchon dans votre exposition sur l'Arbre.
C.D. : une partie de l'intérêt que j'éprouve à faire, à
intervalles réguliers, des expositions thématiques, c'est (outre le plaisir
intellectuel de faire entrer le public à son insu dans des problématiques
esthétiques ou plastiques), celui de pouvoir exposer aux cotés de grands noms,
de très belles œuvres d'artistes moins connus. C'est l'occasion de faire
découvrir des peintres de grande qualité mais qui n'ont pas forcément joué un
rôle majeur.

Charles ANGRAND - le clos normand - 79x97 - non signée -1907-08 - coll.part.
L'histoire n'est pas faite que
d'artistes ayant bouleversé leur époque ; il fallait autour des plus grands,
des artistes pour les connaître et les reconnaître, et nourrir leur époque de
leurs apports, leur donner une profondeur historique.
P.B. : comme Charles Angrand ?
C.D. : oui, oui, il y a un grand nombre d'artistes qui occupent
des places singulières dans l'histoire de l'art et que le grand public ne
connaît pas forcément. Oui, c'est le cas justement d'un artiste comme Charles
Angrand. Les raisons de cette méconnaissance sont assez faciles à analyser au
demeurant. Il faut s'intéresser en profondeur à un mouvement pour découvrir des
peintres comme lui, tant ses œuvres sont rares et parfois difficiles pour qui
n'a pas de véritable compréhension de l'histoire de la peinture.
Par ailleurs, pour un
musée relativement modeste, il est essentiel de faire ce travail de
redécouverte. Il est en effet inutile de publier sur des artistes qui sont déjà
dotés de nombreux catalogues d'expositions monographiques. Le catalogue de
l'exposition Charles Angrand a permis à ce titre de donner une plus large
audience aux recherches de François Lespinasse et c'est, désormais, une
référence pour un plus large public et un outil au service des historiens qui
travaillent sur le Néo-impressionnisme. Bien évidemment, les publications
antérieures de François Lespinasse avaient déjà fait l'essentiel, mais la
diffusion par un éditeur national augmente soudainement cette visibilité en
étant l'occasion de réactualiser les connaissances sur les œuvres réapparues ou
localisées depuis peu. D'autre part, le fait d'avoir pu bénéficier de la
préface d'une figure internationale aussi considérable que celle de Robert
Herbert a permis une plus large reconnaissance de cet artiste.
P.B. : la place de Charles Frechon ?
C.D. : dans cette exposition, Charles Frechon est dans
son environnement artistique et la présence de ses œuvres est parfaitement
pertinente.
Ce n'est probablement pas
le choix qu'aurait fait le Musée d'Orsay à l'occasion d'un thème aussi
ambitieux, mais c'est bien dans la vocation du musée de Pontoise. C'est la
publication de Rouen (Rétrospective Charles Frechon, Musée de Rouen, 2008, NDLR) qui m'a fait mieux connaître ce très
beau peintre qui a apporté une interprétation originale du Néo-impressionnisme.
 |
| Charles FRECHON - l'été à Quevreville-la-Milon -HST 60x73 -1903-04 - coll. part. |
P.B. : serait-il encore un peintre inconnu ?
CD.. : Il faut avouer que son oubli est l'une des injustices
de l'Histoire de l'Art, car il « divise » dès 1889/1990 donc
avant la mort de Seurat et le ralliement de Cross. La raison de cet oubli
provient probablement de son absence dans les expositions internationales
contemporaines du mouvement telles celles organisées par les « XX » à
Bruxelles.
Comme bien souvent, il
faut rechercher l'origine de la méconnaissance d'un artiste par le public dans
la rareté des œuvres et plus précisément, la rareté voire l'absence dans les
collections des musées. La diffusion d'une œuvre contribue grandement à sa
notoriété (son œuvre est loin d'être pléthorique : nombre estimé à environ 850
numéros, alors que Claude Monet en compte environ 2.000 peintures et Pissarro
plus de 1500 NDLR)
P.B. : un espoir ?
C.D. : si un peintre comme Achille Laugé a aujourd'hui pu
réintégrer l'histoire du mouvement, il n'y a pas de raison qu'il n'en
soit pas de même pour Charles Frechon qui, à certain égard, est plus fidèle à
la théorie du mouvement. et qui se rattache à celui-ci directement de par son
amitié avec Charles Angrand.
Quant à ses dessins faits
de touches croisées et virgulées, ils sont de superbes exemples de dessins
néo-impressionnistes !
 |
| Charles FRECHON - automne à Quevreville-la-Milon -HST 65x80 - 1903-04 - coll.part. |
P.B. : Robert-Antoine Pinchon ?
C.D. : ah oui ! Vous faites allusion à la peinture que nous
avons admirée ensemble lors de l'exposition de Rueil (Impressionnistes et
postimpressionnistes de l'Ecole de Rouen, Atelier
Grognard, Rueil-Malmaison, 2011, NDLR).
En effet,
chaque exposition est l'occasion de corriger la vision préconçue que l'on
a des artistes. Certaines œuvres vous font réévaluer cette vision soudainement
et vous apportent, de fait, une bien meilleure compréhension. Cela rejoint tout
ce que nous disions plus haut.
P.B.: comment le jugez-vous ?
C.D. : le « Fauvisme » est un mouvement reliant des
peintres convergeant très ponctuellement et dont les évolutions ultérieures
furent souvent divergentes. Regardez par exemple un peintre comme Louis Valtat
dont les préoccupations esthétiques sont aux marges du Fauvisme. Certains
Fauves évoluèrent vers une forme d'Expressionnisme, d'autres devinrent
Cubistes, beaucoup reprirent des chemins originaux et de fait, bien distincts
par la suite.
Comme beaucoup de Fauves,
Pinchon se souvient autant des Néo que de Monet ou de Van Gogh, quand il peint
ses troncs d'arbres en touches parallèles (Cf. Le Chemin, Neige, exposé).
Il est, dans cet esprit, dans une certaine filiation avec le
Néo-impressionnisme tel que le mouvement évolua après la mort de Seurat. Mais
sa liberté de palette l'associe, ici, à ce moment particulier que fut le
Fauvisme.
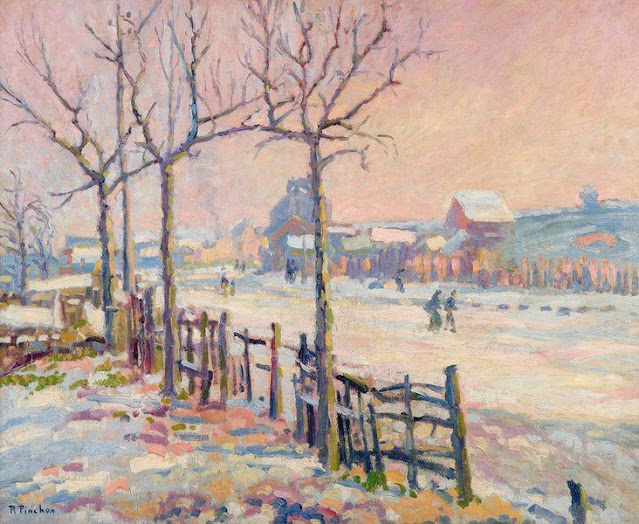 |
| Robert-Antoine PINCHON - le chemin, neige - HST 60x73 - 1905 - coll. part |
On pourrait ajouter qu'à
ce titre, et logiquement, il s'oppose en cela, au « Cloisonnisme » de
nombre de peintres issus de Pont-Aven dans le sillage de Paul Gauguin.
.
P.B. : la fin du XIXème est une période charnière que vous appréciez...
C.D. : il est très important, pour nous, Conservateurs de Musées ou
Commissaires d'expositions, de promouvoir cette période charnière excessivement
riche entre le XIXème et XXème siècle. Nous
devons avoir le courage de sortir des chemins trop rebattus ; c'est essentiel,
notamment en rapprochant des œuvres pour permettre une meilleure compréhension
de l'époque, de ses enjeux, de sa richesse. Par ailleurs, la recherche d'une
cohésion et d'un dialogue pertinent entre les œuvres ainsi réunies constitue
une alchimie fine très stimulante, surtout dans une architecture complexe
comme celle du Musée Tavet-Delacour où toute forme de dogmatisme est vouée
à l'échec.
P.B. : des projets pour 2013 ?
C.D. : un projet
« entre Paris et la côte normande » : Albert
Marquet et les bords de Seine, pour l'automne 2013.