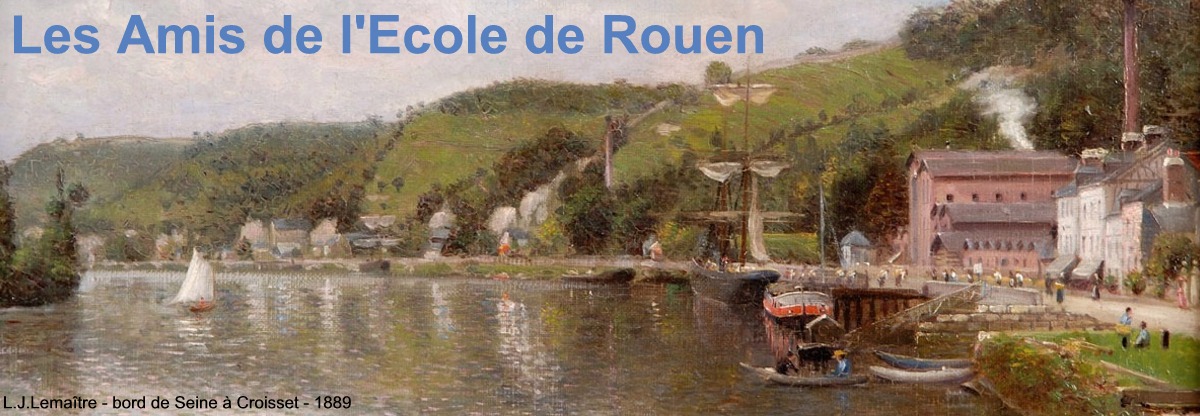Eté 2015 : Interview de Sylvain AMIC, Directeur des Musées de Rouen
Pierre Buychaut : alors, Sylvain AMIC, que
donne cet Hommage à Pierre HODÉ ? *
Sylvain Amic :
c’est un bel hommage, mais qui reste modeste : l’aspect des "Rythmes
Mécaniques" et sa collaboration au "Pavillon des Chemins
de Fer" n’ont été que partiellement abordés, idem pour son
approche du "Théâtre Synthétique". Et l’angle sériel de son
œuvre n’a pas été vu.
De plus, de nombreuses toiles qui paraissent exceptionnelles, ne nous sont
connues que par photo. Mais cela n’interdira pas une vraie rétrospective
future.
C’est un artiste très singulier !
* Merci de bien vouloir consulter
aussi dans la catégorie "la rubrique de Pierre BUYCHAUT" les
interviews de Marie-Claude COUDERT (parue en avril 2015) et celle de Sylvain AMIC (décembre 2013 - nouvelle parution le 21/07/2015)
PB : nous sommes tout ouïes…
SA : en observant
son œuvre par son aspect chromatique, on remarque, par exemple, que le choix du
coloris chez HODÉ est très évocateur de la matérialité des objets :
l’acier, le bois…
PB : une toile a-t-elle retenu votre
attention ?
SA : Les
motifs "à la cible" sont très
intéressants ! Ils me rappellent ces artistes français tentés par le
Futurisme comme Henry VALENSI (1883-1960) (mouvement italien né en
1909, lié à la représentation picturale du mouvement - ndlr)
 |
| Pierre HODE - la rue de l'épicerie - 1922--HST 61x61 - coll.part |
PB : beaucoup font la relation avec Sonia
DELAUNAY…
SA :
oui… ?? Ah bon !Pas du tout ! A mon avis, pas du tout !!
Je m'explique : oui, sur le plan formel on peut dire cela.
Mais, à mon avis, c’est un peu rapide. Les motifs de Robert et Sonia DELAUNAY
sont circulaires certes, mais il s’agit de distribuer des rapports de couleurs.
 |
| Pierre HODE - "le village" 1922 - HST 54X65 - coll. part |
HODÉ, ce n’est pas ça : il peint un motif au travers d’un
prisme transparent qui décompose le réel en cercles concentriques. Il emploie
des couleurs sombres, sans les changer d’un cercle à l’autre. Ainsi le motif
est décalé, dans une espèce de décomposition des instants. C’est plus une mise
en mouvement d’un motif, contrairement aux DELAUNAY, où c’est la vibration de
la couleur qui crée le mouvement. DELAUNAY, c’est la recherche d’une harmonie
solaire, d’une fusion du motif dans la lumière et la couleur. HODÉ, c’est
comment la vision est transformée au travers différentes temporalités !
PB : on est en 1922. N’est-ce pas un peu
tardif pour du Futurisme ?
SA : c’est vrai.
Mais c’est un mouvement, comme le surréalisme, qui a une longue histoire, et
s’étale sur plusieurs générations.
PB : rapprochez-vous son œuvre du
Cubisme ?
SA : Je trouve
qu’il tire plutôt vers le Purisme (mouvement post-cubiste - ndlr),
en particulier dans ses natures mortes, qui sont finalement plus proches de
OZENFANT (Amédée OZENFANT 1886-1966) ou LE CORBUSIER (Charles Jeanneret dit...,
1887-1965) que du cubisme. On peut également évoquer André LHOTE (1885-1962).
Dans tous les cas il s’agit d’échos du cubisme : simplification
des formes, usage de l’imprimé, collage d’espaces, mais cela reste bien loin du
cubisme qui déstructure la forme pour en restituer toutes les facettes
amalgamées dans le plan du tableau.
 |
| Pierre HODE "nature morte au pot blanc" - 60x73 - coll.part. |
Le Cubisme Synthétique, ce n’est pas encore ça non plus, ni le Cubisme Analytique ! Pas non plus le Futurisme d’Umberto BOCCIONI (1882-1916).
PB : on parle également de METZINGER, LA
FRESNAYE…
SA : Jean METZINGER
(1883-1956) est un théoricien et ses compositions des années cubistes vont très
loin dans la complexité de la forme. LA FRESNAYE (1885-1925) est au fond un
grand classique : c’est un merveilleux dessinateur et ses compositions
sont très savantes. HODÉ se soumet beaucoup plus au motif que Metzinger, et
n’utilise pas le langage allégorique de LA FRESNAYE.
Justement, c’est la singularité de Pierre HODÉ qui fait qu’on ne
sache pas trop où le ranger !
Bon, quand il y a les cartes à jouer, les lettrages, on parle à
tort de cubisme. Regardez : Pierre BONNARD (1867-1947) adore mettre des
lettrages dans ses compositions tout comme des jeux de miroir, chers à
HODÉ ! On ne pas dire pour autant que HODÉ ressemble à BONNARD !
PB : HODÉ, un artiste difficile à
cantonner…
SA : oui, comme
tous ces petits maîtres peu connus et savoureux qui gravitent dans les milieux
des avant-gardes. Je pense à TIRVERT (Peintre de l’Ecole de Rouen, l’École
1881-1948), Félix TOBEEN (1880-1938), Léopold SURVAGE (1879-1968), Serge FERAT
(1881-1958), André MARE (1885-1932), Marie WASSILIEFF (1884-1957), Nathalia
GONTCHAROVA (1881-1962), et puis les premiers DUMONT (Peintre de Rouen,
1841-1936) de "La Section d’Or"…
Tous ont inventé des formes. Ils ne sont pas peintres cubistes,
mais ils aiment ce langage moderne. Chacun a trouvé une combinaison qui lui est
propre, un public qui lui est propre, ce qui fait la richesse de cette époque.
PB : les Ports de Hodé ?
.jpg) |
| Pierre HODE "la guepe" 1923 - HST 38X55 - coll.part. |
SA : c’est
certainement la partie de son œuvre qui est la plus célèbre. Mais au-delà des
remorqueurs, ce que j’aime beaucoup, c’est sa capacité à décrire des réalités
humaines, comme dans le tableau du musée. On est au "Café du Port",
mais ce n’est pas une carte postale : la mise en abîme des reflets, les
vitres et les miroirs, changent toute la perception de ce moment, et tout à
coup fait émerger autre chose.
Très peu d’artistes ont été capables de retranscrire ce vertige
du réel. Pour le coup, je n’ai pas d’équivalence en tête. Ah si !!!, on peut
évoquer les Nouveaux Humanistes, Léon ZACK (1892-1980), Philippe HOSIASSON
(1880-1978), dans leurs débuts.
PB: des projets en cours ?
SA : nous
travaillons à la construction d’un PÖLE MUSEAL à
l’échelle de la Métropole qui, cela dit en passant, couvre un territoire où
l’École de Rouen était fort active. Ce sera une structure adaptée à la
valorisation des Écoles Régionales !
PB : expliquez-nous…
SA : l’idée est de
créer une sorte de Musée éclaté qui regrouperait les beaux-arts, les sciences
et techniques, le patrimoine industriel, (comme le Musée de La Corderie Vallois
à ND de Bondeville), les sciences naturelles, les antiquités, l’archéologie, la
littérature, les archives, etc...
Tous ces savoirs ont souvent été incarnés par des personnalités
régionales qui ont constitué des collections en lien avec l’histoire du
territoire, qu’il s’agisse de fouilles, de collectes ou de représentations.
Tout cela est très complémentaire, et compose une sorte de portrait d’un groupe
humain à travers son histoire. Il y a plus de liens qu’on ne croît entre ces
fonds.
PB : une mise en lumière du Patrimoine
Normand ?
SA : oui, ainsi
cette structure plus adaptée, sera le fer de lance de la mise en valeur du
patrimoine métropolitain, que ce soit à travers des écoles, des personnalités.
Et les opportunités d’expositions seront supérieures !
De plus, elle se tournera vers un public plus large que celui
des érudits : toutes les approches, toutes les curiosités seront
autorisées.
PB : Un échange de compétences ?
SA : C’est ce qui permettra de relier tous ces patrimoines entre eux : quel rapport entre La Fabrique des Savoirs et Les Beaux-arts ? A priori aucun ; or, nous avons par exemple dans nos collections un tableau d’Émile MINET représentant l’activité textile.
Cela peut avoir du sens de le montrer à Elbeuf. Idem avec le
Musée des Antiquités dont les collections et celles des Beaux-arts ont été
liées : céramiques et antiquités étaient, jadis, présentées ensemble.
D’autres rapports sont possibles : une sculpture romaine du début de l’ère
chrétienne dans une salle du XVIe siècle au Beaux-arts permet de montrer de
façon explicite comme l’antiquité inspire la Renaissance. Notre grand tableau
de Joseph-Désiré COURT (1797-1865), "Le martyre de Sainte Agnès",
où l’on voit le Forum de Rome, pourrait côtoyer des pièces de l’antiquité
romaine. Je suis persuadé que ces échanges seront très stimulants.
 |
| Joseph-Désiré COURT-"le martyre de Ste-Agnès" 1858-HST 496x812cm.-coll.MBAR; |
PB : vous avez évoqué des personnalités
locales ?
SA : car ces
personnalités, vivant à la même époque, se rencontraient, appartenaient aux
mêmes cercles, échangeaient leurs savoirs. Leurs collections étaient
universelles, moins spécialisées que celles d’aujourd’hui. Ces esprits très
ouverts collectionnaient tout, aussi bien les Beaux-arts que la Céramique ou la
Ferronnerie… Cette structure va permettre de décloisonner ce que l’on a découpé
aujourd’hui par commodité, en catégories.
Je regretterais que quelqu’un qui se passionne pour les
techniques, ne rentre pas aux Beaux-arts où il peut les voir à l’œuvre. Dans
notre exposition Sienne , nous montrons le travail de
l’artiste et de son atelier pour produire au XIVe siècle des panneaux
peints : le bois brut puis enduit, la toile noyée, le gesso (une
préparation à base de gypse et de colle de peau NDR), la feuille d’or..., toute
une stratification de préparations avant l’application de la peinture. Il n’y a
pas que l’image qui intéresse le grand public, l’histoire matérielle des objets
se révèle être très attirante.
PB : vous allez bouger, diluer les lignes
de démarcation d’orientation de ces Musées !
SA : surtout
pas ! Tous ces musées ont leur identité et leur public. Tous ces Musées
sont labellisés « Musées de France », avec les
qualités d’exposition et de conservation requises, des personnels scientifiques
spécialisés compétents qui se complètent entre chaque musée.
Dans leur spécialisation, ils sont le reflet d’une volonté
opiniâtre d’ordonner le monde. Avec ce projet, nous n’allons pas tout
bouleverser, mais tenter de retrouver cette curiosité universelle qui a présidé
à la création des musées.
PB : le Musée des Beaux-arts sera
pilote ?
SA : Il est le plus
visible, mais sa fonction sera d’être tête de réseau et de redistribuer une
part de son « visitorat » vers les autres sites ; en
terme d’organisation, il pourra apporter aux divers musées des services qu’ils
ne possèdent pas, administration, médiation, communication, développement des
ressources, mécénat, location d’espaces…
Chacun de ces musées a une mission propre, et une fonction
d’animation du territoire. En créant des "temps" communs, nous
inviterons le public à circuler d’un site à l’autre, moyennant une incitation
tarifaire par exemple, des abonnements, des invitations croisées... La
circulation des publics sera l’enjeu premier du PÔLE MUSÉAL.
PB : une mutualisation de moyens ?
SA :
d’abord une mutualisation de compétences et de savoir-faire. Imaginez ce que
pourrait être un programme de conférences commun : c’est l’Université de
tous les savoirs !
Nous souhaitons créer une offre numérique commune très
attractive qui devienne une plate-forme de connaissances et qui permette de
suivre tous les programmes et les cycles de conférence du pôle muséal, par
streaming par exemple ; pouvoir mettre en ligne ce contenu vivant et
également les bases de données des collections qui sont inaccessibles au grand
public aujourd’hui.
PB : oui, oui, très innovant…
SA : et enfin, ce
qui m’importe le plus, savoir ce que le public pense et désire. Le Musée est
une institution qui ne vous demande pas votre avis. A ce jour, on on sait à
peine ce que le public a en tête en rentrant au Musée. Nous n’avons pas
conscience de ses goûts et préférences. C’est quelque peu anachronique à l’ère
des réseaux sociaux !
N’oublions pas, que le projet des musées, créés à la Révolution,
était de restituer un patrimoine au public. Depuis, malgré tous les efforts de
démocratisation, ce projet initial a été quelque peu confisqué par les "sachants".
A l’inverse, dans L’assommoir de Zola, la noce de
Gervaise Macquart se rend au Musée pour y passer un bon moment. Certes, ils
détonnent dans le paysage, mais cet épisode montre que le Musée était alors un
lieu très ouvert, gratuit et populaire !
Enfin, ce projet de PÔLE MUSÉAL doit être
l’occasion de remettre en question nos pratiques. Par exemple, durant "Le
Temps des Collections", nous invitons des personnalités extérieures
qui ne sont pas issues du monde des musées (Christian LACROIX en 2012, Olivia
PUTTMAN en 2013, Laure ADLER en 2014, Agnès JAOUI en 2015 - ndlr) ;
c’est un premier pas vers l’ouverture nécessaires des musées vers d’autres
univers.
PB : un nom pour ce PÔLE MUSÉAL ?
SA : nous n’avons
pas encore trouvé de nom. On peut le penser en terme géographique comme
un archipel, ou stellaire comme les pléiades ; ou
bien d’aire urbaine, car une bonne part de ces musées est regroupée
sur un petit périmètre ; ou encore sous l’angle de la curiosité ; ou
sous celui de l’échange du forum….
PB : la création du PÔLE MUSÉAL ne
sera-t-elle pas le prétexte de refermer les portes du Musée de Rouen à
"L’École de Rouen" ?
SA : Au
contraire ! Je pense que les œuvres de ces artistes sont propices à de
multiples lectures, dans divers établissements.
Au musée des Beaux-arts, nous pouvons reconduire ce que nous
avons fait pour Pierre HODÉ, une salle entière dédiée sur presque une année (de
novembre 2014 à août 2015 - ndlr).
PB : la rétrospective Charles FRECHON de
2008, c’était autre chose ! *
* consulter l'ouvrage
édité pa les Musées de Rouen lors de l'exposition Ch. FRECHON de mai à
septembre 2008 organisée au MBARouen avec la collaboration de l'Association et
de F.Lespinasse.
SA : ah, oui, c’est
vrai que cela n’avait rien à voir. Vous étiez très, très contents,
mais, dîtes-moi, combien de visiteurs l’ont vue ?
PB : 13.580 exactement.
SA : ce nombre de
visiteurs doit nous interroger ! C'était un très beau projet, un
remarquable catalogue scientifique et documenté mais qui n'a touché que 13.000
visiteurs, dont probablement une majorité de Rouennais beaucoup grâce à
votre réseau… Il faut que nous trouvions les possibilités de faire
connaître ces artistes au-delà de ce cercle d’amateurs.
Pendant la période où nous avons montré Pierre HODÉ, le Musée
aura reçu près de 100.000 visiteurs. Comme vous le savez, le billet
d’entrée à l’exposition Sienne permet de visiter également les
collections. On peut donc supposer que nous aurons fait découvrir cet artiste à
un plus un large public.
PB : les expos "moyen de gamme"
sont-elles vouées à disparaître ?
SA : il est
nécessaire de trouver une complémentarité entre les projets et les époques.
Donner une visibilité aux artistes Rouennais ce n’est pas
seulement le XIXe siècle mais aussi XVIIe. Nous
avons consacré une exposition à Nicolas COLOMBEL (Sotteville-les-Rouen
1644–1717), exposition au Musée des Beaux-arts de Rouen 2012-2013, avec 12.000
visiteurs). Nous avons permis de redécouvrir Adrien SACQUESPÉE
(Caudebec-en-Caux 1629–1693,) dont nous possédons 7 tableaux accrochés pour
"Le Temps des Collections 2014-2015".
 |
| Adrien SACQUESPEE "le martyre de St-Adrien" *1659 -coll. MBARouen |
Ce qui nous manque, c’est l’échelon entre ces deux modèles que
sont : petite exposition-dossier dans le cadre du "Temps des
Collections" et exposition internationale sur 1000m². J’aimerais
retrouver la possibilité de monter des expositions d’automne-hiver, avec
catalogue, dans les 460m² de la salle d’exposition de l’aile nord. Ce serait le
format idéal par exemple pour une exposition « Albert LEBOURG » avec
une soixantaine de tableaux essentiels, jalons de sa production.
Et puis, ensuite, il faudrait "coorganiser" cette
exposition afin de partager les coûts, car nous n’obtiendrons pas le niveau de
mécénat de « Sienne » par exemple !.
Or, beaucoup de Musées possèdent une surface d’exposition
temporaire de l’ordre de nos 460m², ce qui serait un atout.
PB : vous savez que vous pouvez compter
sur l’Association qui serait source d’économies !
SA : oui, je vous
en remercie.
Pour LEBOURG, il faudrait que les tableaux qui proviennent de
l’AER côtoient les tableaux d’Orsay, et de quelques grands musées, aussi je
préfère attendre d’avoir le budget adéquat. Pour HODÉ, nous avons préféré le
faire dans le cadre du "Temps des Collections" car il y
avait une forte attente de la famille.
Pour l’instant nous nous efforçons d’obtenir les moyens pour que
chacun des musées du PÔLE puisse porter un projet d’envergure chaque année. Au
Musée de la Céramique, par exemple, nous présenterons l’an prochain une
exposition « MASSÉOT ABAQUESNE » (ver500 – avant 1564), coproduite
avec le Musée d’Ecouen. Né dans le Cotentin, il s’est installé à Rouen en 1526
où il a développé l’art de la faïence qui a fait la renommée de notre
ville : ce sera notre contribution en 2016 à la valorisation des artistes
d’ici !
Propos recueillis par Pierre BUYCHAUT
 |
MASSEOT ABAQUESNE
"le Déluge- Embarquement sur l'Arche" (1550) Faïence tryptique exposé
au Château d'Ecouen -Musée National de la Renaissance d'Ecouen