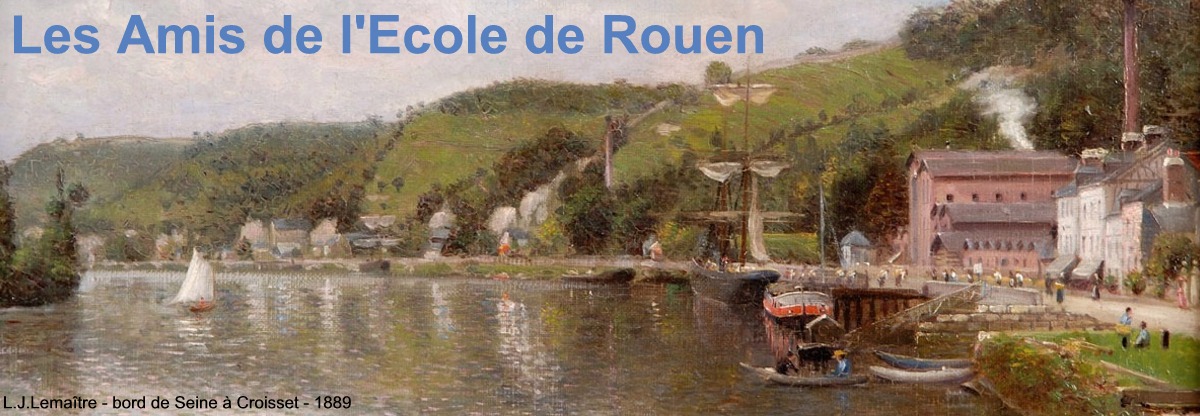Charles ANGRAND, un Normand parmi les plus importants peintres
 |
| Charles Angrand (1854-1926), Dans l’île des Ravageurs, 1885, huile sur toile marouflée, signée, 46 x 55 cm. |
A
Lorient, le samedi 19 décembre 2015 s’est vendu un tableau de l’artiste
« Dans l’ile des ravageurs, en automne » peint en
1885, 136.000 euros. A ce prix, ajoutons les frais de 14,40 % et
nous arrivons à la somme très élevée de 155 584 euros.
De
format 10 : 0,46 X 0,55, cette petite toile impressionniste est une
exceptionnelle découverte.
Qui est donc ce peintre, né le 19 avril dans le bourg de Criquetot-sur-Ouville en plein pays cauchois à équidistance des falaises de la côte d’Albatre et des boucles de la Seine ?
 |
| Charles Angrand - autoportrait - 1880 |
Ses
œuvres figurent dans les plus grands musées du monde : Metropolitan Museum
New-York, Dallas Museum, National Gallery Londres, Orsay Paris, Petit-Palais
Genève, Van Gogh Museum Amsterdam, Tournai, Ny Carlsberg Glypothek
Copenhague mais aussi Rouen, Helsinki, Bagnoles-sur-Cèze, Dieppe… Et
pourtant son œuvre peint ne comporte pas plus de 80 numéros.
Destiné par ses parents à l’enseignement, le père est lui-même instituteur à Criquetot de 1849 à 1875, Charles Angrand va gagner aRouen et devenir répétiteur au Lycée Corneille de Rouen. Là, dans la ville aux cent clochers, il suit les cours de l’Académie de peinture et de dessin située dans l’enclave Sainte-Marie à deux pas du Lycée.
En 1875, il visite l’exposition Corot à Paris et décide de se tourner vers la peinture.
Son premier envoi officiel est pour le 26ème Salon municipal de Rouen avec « Fleurs des champs » en 1878. Il souhaite partir pour Paris dès 1’année suivante mais sa demande est refusée.
A l’Académie, ses professeurs ont pour nom : Gustave Morin (1809-1886) Philippe Zacharie (1849-1915) puis Edmond Lebel (1834-1908), ses collègues Charles Frechon (1856-1929) et Joseph Delattre (1858-1912). L’un des anciens élèves de l’Académie est Léon Jules Lemaitre (1850-1905) à qui le 21 mars 1879 le conseil municipal de Rouen refuse la demande du peintre de voir prolonger une bourse de sixième année à Paris.
Ces jeunes artistes sont gagnés par le pleinairisme, et l’Impressionnisme, dont les expositions se sont tenues en 1874,1876 et 1877 et vont se poursuivre à cinq reprises (1879, 1880, 1881, 1882 et 1886).
Léon Jules Lemaitre est le mentor rouennais de ces artistes. Tous optent pour ce mouvement novateur.
Charles Angrand adresse en 1880 au Salon de Rouen « La Gare Saint-Sever », « ce paysage, quel paysage!, appartient à l’Ecole Impressionniste … » écrit le critique du « Nouvelliste » puis en 1882 à ce même Salon « Le Gardeur de dindons » et « Autoportrait » (fusain).
 |
le gardeur de dindons - 1881 -
coll.part. |
À la rentrée scolaire de 1882, il est
nommé comme répétiteur au collège Chaptal, 45 Boulevard des Batignolles à Paris.
Là, commence l’aventure parisienne qui va durer quatorze ans.
En 1883, Charles Angrand tente le Salon mais est refusé. Il écrit à Claude Monet pour rejoindre le groupe et essuie un nouveau refus.
La proximité de la place Clichy, du Café Guerbois, de la Nouvelle Athènes depuis Chaptal, lui permet de rencontrer les meilleurs éléments des milieux littéraires et artistiques de Paris, alors capitale mondiale des Arts.
Il adhère à la « Société des jeunes artistes » où il expose. Il est remarqué par le journaliste de Lutèce qui écrit le 29 décembre : «… signalons encore M. Angrand qui fait de l’impressionnisme, sans tomber dans la charge … ».
Mais, surtout il va faire partie des fondateurs de la Société des artistes indépendants « basée sur le principe de la suppression des jurys d’admission, a pour but de permettre aux Artistes de présenter librement leurs œuvres au jugement du Public ». Il rencontre Georges Seurat, Paul Signac, Albert Dubois-Pillet.
L’éloignement avec ses parents donne à l’artiste le devoir de les informer d’une manière régulière, mais aussi ses amis peintres en particulier Delattre et Frechon.
Cette correspondance nous permet ainsi de mieux connaitre l’artiste et les événements artistiques de la capitale.
Le 29 avril 1884 à ses parents : « …encore refusé : ils sont constants dans leur exclusivisme. Peut-être exposerai-je néanmoins. Un groupe d‘artistes indépendants s‘est réuni pour décider une exposition privée (…) Ce groupe d’indépendants n’a rien de commun avec les impressionnistes. L’exposition ne sera rien autre chose qu’un salon des refusés. »
Et cette autre missive : « Je suis allé jusqu’au boulevard Magenta voir un peintre de mes amis, un impressionniste. Je tenais à le voir. On m’avait dit qu’il terminait un grand tableau. C’est Seurat, celui-là même qui avait acheté mes Fleurs ».
La Société des Artistes Indépendants est créée le 4 juin 1884.
La première exposition se tient du 10 décembre 1884 au 30 janvier 1885 Charles Angrand envoie « Dans le jardin » et « Dans la basse-cour ». Les critiques sont sévères dans « La France » du 12 décembre : « Les Indépendants, c‘est-à-dire les refusés du Salon annuel, les fruits secs de la palette et de la terre glaise se sont organisés en société ( …) C‘est insensé! Voyez-vous les écoliers apportaient leurs barbouillages et leurs cahiers de devoirs ».Dans «La Ligue » : « quel jury un peu éclairé consentirait à admettre les productions des neuf dixièmes d’entre eux. On sort de là attristé et colère ». Tel est le climat.
Après cette exposition, il écrit à ses parents : «je suis allé reprendre mes toiles aux Indépendants. Nous sommes arrivés à un déficit assez considérable. C’était à prévoir. Le choléra n’était plus d’actualité. A Paris, l’occasion est tout. Résultat : nous sommes quelques-uns que l’exposition a fait connaître. Avec de l’obstination, nous pouvons peut-être nous en tirer. Durand-Ruel est en train de passer une réclame sérieuse de notre côté (j’entends du côté des anciens du groupe) ; nous ne pouvons qu’y gagner».
 |
la couseuse - 1885 - coll.part. |
En 1885, les correspondances familiales
font le point sur le quotidien de l’artiste. En mai, il informe la famille du
décès de Victor Hugo. A son retour à Criquetot pour les vacances scolaires, il
se replonge dans l’univers normand.
Il entreprend deux tableaux importants
« La Couseuse », sa mère cousant dans la pièce principale de
l’habitation, et une étude éponyme. « Dans le jardin »
représentant son père bêchant dans le potager jouxtant la maison.
Puis de retour à Paris, il se rend sur
le bord de Seine au nord de la capitale. Charles Angrand aime se rendre à
Asnières. Il apprécie tout particulièrement la tranquillité de l’ile des
ravageurs habitée par des chiffonniers et peut dresser là, le format 10 (0,46 X
0, 55) objet de ces lignes.
Comme l’écrit Robert L. Herbert : « la
Seine, dans la banlieue de Paris était depuis longtemps le point où se
rejoignaient la ville et la campagne, mais cette imbrication était devenue plus
sensible avec la prolifération des usines et l’envahissement progressif des
terrains vagues, par des maisons de commerce et les immeubles locatifs».
En 1886, plusieurs événements
considérables ont lieu :
-
la huitième et dernière exposition du groupe impressionniste, du 15 mai au 15
juin où Georges Seurat présente « Un dimanche après-midi à la Grande
Jatte » peint selon la méthode qu’il vient d’inventer : la division du
ton.
-
l’apparition du terme « néo-impressionniste » lancé par
Félix Fénéon,
-
l’arrivée de Vincent Van Gogh à Paris,
- le
manifeste du symbolisme par Moréas …
En cours d’année, Charles Angrand
exécute plusieurs toiles importantes : « La Seine à Saint-Ouen » et
deux formats 30 : « la Ligne de l’ouest à sa sortie de Paris, vue
prise des fortifications et, Terrains vagues (Clichy)».
Du 21 août au 21 septembre, la seconde
exposition de la société des artistes indépendants a lieu dans un baraquement
des Tuileries à Paris. Charles Angrand est à Criquetot-sur-Ouville où il
exécute sa première toile divisionniste « Un Coin de ferme »
Grâce à l’amitié et complicité du
critique Jean Le Fustec (1855-1910), collègue à Chaptal, il peut accrocher six
toiles au salon parisien. Ce sont : « Femme cousant; La Ligne de
l’ouest; Le Fumier; La Seine, le matin; Terrains vagues (Clichy) et Dans l’ile
des ravageurs, en automne »
 |
| le fumier - 1890 - col;part. |
A l’occasion de la dernière exposition
du groupe apparait Félix Fénéon (1861-1944) remarquable critique d’art,
journaliste. Il rend compte de l’envoi du Normand : « Angrand qui
exposait pour la première fois en 1883, n’a pas adopté la facture impersonnelle
et comme abstraite des dissidents de l’impressionnisme : sa brosse, d’une
violence rusée, travaille et triture ingénieusement une pâte épaisse et
plastique, la configure en reliefs, l’érafle, l’écorche, la guilloche et la
papelonne. Le requièrent surtout des scènes de la vie agreste normande, et les
environs immédiats de Paris : ses Terrains vagues à Clichy (1886), sa Ligne de
l’Ouest à sa sortie de Paris, sa vue prise des terrains vagues (1886) se particularisent
par leur sapidité, leur mélancolie rude, une tendance aux tons graves ».
Deux autres critiques sont
particulièrement intéressantes, celles de Le Fustec dans Le Journal des
Artistes dirigé depuis 1882 par Louis Alphonse Bouvret (1831-1898). La
première est du 22 août : « …s’ils étaient des adeptes de
l’École, ces artistes auraient parmi les paysagistes connus des notoriétés
remarquables parce qu’ils sont riches en talent. Nous leur demandons qu’ils
nous donnent au moins l’équivalent de ce qu’ils nous accorderaient s’ils
étaient des habitués du Salon », et d’ajouter le 29 août
: « reste Angrand. A première vue les œuvres de cet artiste vous
imposent l’opinion qu’ils ont été faits devant la nature. Que vous preniez le
paysage normand ou le paysage parisien, l’impression est la même. Il y a dans
ces toiles une sincérité à laquelle on ne se trompe pas. Ses verdures sentent
le terroir. Ses paysages d’automne aux environs de Paris vous parlent du sol
crayeux qui les porte, de même que les gazons normands plantureux, gras,
puissants vous racontent la terre vigoureuse qui les produit (…) En somme,
Angrand fait œuvre d’artiste en soumettant sa palette et son pinceau à
l’observation. Il se place ainsi dans le grand champ de la liberté artistique
où nul ne peut se donner carrière s’il n’a en lui les ressources suffisantes
pour être original. Les toiles qu’il a données à cette exposition affirment
énergiquement son originalité. A vrai dire il n’est pas encore arrivé à son but
dans cette voie. Mais il y a chez lui un progrès qui a été constaté dès le
premier jour et qui, nous en sommes convaincu, persistera tant que cet artiste
fera œuvre d’impressionniste véritable en se maintenant dans l’observation ».
De l’été 1886 à la mort de Seurat, survenue le 29 mars 1891, Charles Angrand va réaliser une dizaine de toiles divisées (L’Accident, La Seine à l’aube, Les Moyettes, Scène de moisson, Le Fumier …)
 |
l'acccident - 1887 - coll.part. |
Il expliquera à Eugène Brieux
(1858-1932) en mars 1889 les raisons de ce choix et reviendra sur ces toiles
précédentes : « …J’indique cette tendance à raison de la volte-face que
je dois maintenant avouer et qui m’a amené, non sans des études intermédiaires
se réclamant de Monet : Les terrains vagues, l’Ile des Ravageurs, La Ligne
de l’ouest - à la recherche actuelle sur laquelle je vous demanderai de
m’étendre un peu … ».
La toile qui vient d’être vendue à Lorient, dont le premier propriétaire, ainsi qu’il est consigné dans le Mémorandum manuscrit des œuvres données ou vendues, fut Monsieur PLÉ, fondateur de la maison de fournitures pour artistes à Paris. C'est un élément supplémentaire pour affirmer la place exceptionnelle de Charles Angrand parmi les peintres de sa génération.
Terminons par cette maxime du peintre : « Le tableau doit être avant tout une composition, c’est-à-dire une organisation par l’esprit, des lignes, formes, couleurs, en vue d’une harmonie expressive. ».
D’autres découvertes sont prévisibles, et elles apporteront une nouvelle preuve indiscutable de l’immense talent de cet artiste si peu à l’honneur dans sa contrée natale.