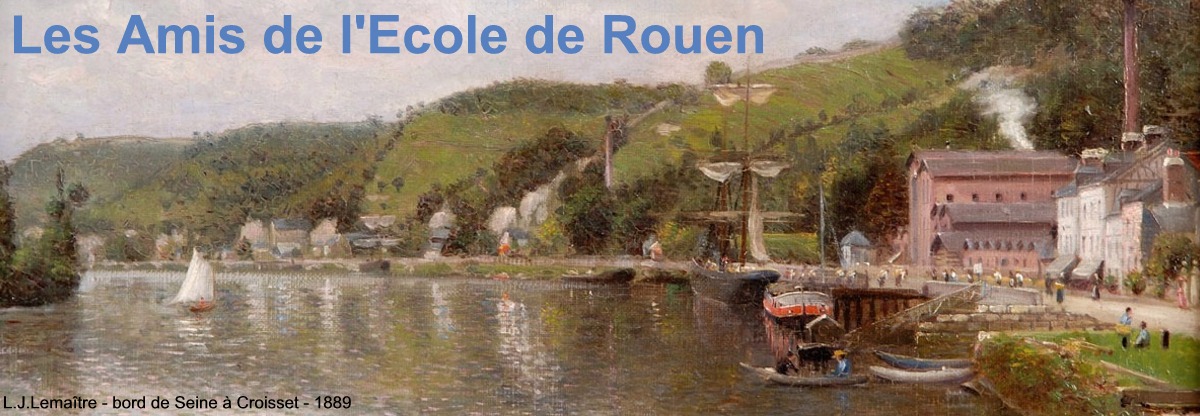Eugène BRIEUX à ROUEN (1889 à 1892)
2ème partie
Ses relations avec Charles ANGRAND, Joseph DELATTRE, Charles FRECHON, Léon-Jules LEMAITRE.
Dans "Le Nouvelliste de Rouen" du 1er avril,
un chaleureux hommage est rendu à Alphonse Guilloux (15); Brieux écrit, sous le titre
" Ateliers d’artistes"::
15) Alphonse Guilloux (1852-1939) fils de sculpteur, Ecole des
Beaux-arts de Rouen, où il se lie d’amitié avec Zacharie, Lemaitre, Dubosc et
Lebourg, puis Paris. Expose au Salon, Salon de Rouen, Exposition
Universelle 1889, auteur de nombreux bustes, médaillons et monuments (Dubosc,
Noël, Pouyer- Quertier, Rollon ..).
« Rouen possède plusieurs artistes
d’un très réel talent, qui à force de volonté, à force de combattre, sont
arrivés à se faire un nom à Paris, à représenter dignement leur ville natale au
Salon annuel, à y remporter des récompenses. Guilloux, Zacharie, Frechon,
Delattre, Angrand, Lemaitre, de Bergevin... ».
Le 26 avril, dans ce même journal, il persiste et décide de
rendre un vibrant et cordial hommage à ses amis artistes rouennais :
Angrand, Delattre, Frechon et Lemaitre. Il écrit un long papier :
"Les Impressionnistes à Rouen".
"Comme
les trois mousquetaires, les impressionnistes rouennais sont quatre ;
comme les trois mousquetaires encore, ils sont jeunes, ardents, aimant la lutte
et n’ont pu se garder, à un certain moment, de céder au désir « d’épater
le bourgeois » ce à quoi ils ont réussi en attendant mieux.
Il
est certain que l’on a ri, et de bon cœur, devant les premières toiles de
Lemaitre ; certain encore qu’on s’est esclaffé devant les pointillés de M.
Angrand ; il est indubitable qu’on a levé les épaules devant les paysages
de Delattre, et le jury du Salon met une persévérance à refuser les toiles de Frechon.
On les a tout d’abord pris pour de joyeux fumistes. En quoi on a eu tort. C’était sérieusement que ces jeunes gens heurtaient le goût du public. Ils poursuivaient un but nettement fixé ; ils ne cherchaient pas un simple succès de scandale ; ils demandaient tout unanimement qu’on voulut bien les regarder et discuter avec eux.
Ils étaient sincères; ils le sont. Ils l’ont
prouvé, et de façon la plus évidente, puisqu’ils ont accepté de dures
privations puisqu’ils les ont supportées pendant plusieurs années, et qu’ils
sont arrivés à ceci : qu’à présent le nombre des rieurs diminue, tandis
que celui des acheteurs augmente... sans exagération toutefois.
Ils
ont cette ambition, de rendre la nuance insaisissable, indescriptible, de la
vibration de la lumière dans l’air. Aucune couleur ne donne cela ; c’est
comme un chant qui ne peut se noter, comme une idée qu’on voudrait exprimer et
pour laquelle les mots n’existeraient pas..
(…)
Tels sont les représentants de la nouvelle école à Rouen. Nous serons heureux
si nous avons pu convaincre ceux de nos concitoyens qui en doutaient, de la
sincérité de leurs efforts et de leurs talents. Quant à eux, ils persévèrent
dans leur tâche, soutenus dans la lutte par l’étroite amitié qu’ils se sont
voués, et le temps n’est pas si loin peut-être où ils auront à mettre en commun
non plus des tristesses et des déceptions, mais les joies vives du succès
mérité et si longtemps poursuivi. "
Tel est le chaleureux message adressé par Eugène
Brieux
Le 11 juillet 1889, Joseph Delattre écrit à son ami
Charles Angrand :
« Mon
cher Angrand,
Mon
intention était cette année de n’envoyer nulle part pas plus à cette exposition
des Amis des Arts qu’à celle des Indépendants. Mais puisqu’il en est ainsi,
puisque vous le désirez les uns et les autres j’exposerai avec vous….Lemaitre
paraît lui aussi satisfait, l’article de Brieux l’a remonté. J’ai vu de lui en
passant devant chez Chaulin deux petites charmantes toiles : 1) coin de
marché aux fleurs 2) Cours Boïeldieu le matin – cette dernière lui a été
achetée.
Je
t’embrasse.» (16)
16) Archives privées.
Les réunions de La Cafetière vont bon train et il arrive que
Charles Angrand comme membre correspondant, vienne assister aux réunions. Entre
peintres alors, la méthode de Seurat est l’objet d’intenses discussions, et les
artistes boivent une sorte d’absinthe appelée par Henri Vignet de
« l’urine d’alouette ».
Durant l’été, Léon-Jules Lemaitre écrit à Frechon:
« L’ami
Brieux vient de recevoir une lettre d’un certain M. Gouellain membre de la
Société des Amis des Arts l’informant qu’on avait l’intention de nous donner un
panneau pour que nos tableaux se trouvent réunis comme nous en avions manifesté
le désir … Quant à Delattre nous ne pourrons guère compter sur lui. On peut
compter sur moi pour quatre toiles de 6,8,15,25 à peu près. Il faut absolument
faire un effort. Tâchons de dépenser beaucoup de talent sur de petites toiles
(de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace). A toi
cordialement. » (17)
17) Archives privées. Il s’agit, à ce jour, de la seule
lettre connue.
Le "Salon des Artistes Indépendants" ouvrait le 3
septembre 1889 à Paris.
A Rouen allait se dérouler du 15 octobre au 15
novembre le concours de la Société des Amis des Arts (fondée
en 1834) entre les artistes normands, nés ou domiciliés dans l’un des cinq
départements, dans le musée de peinture de la ville Le 11 octobre,
Georges Dubosc ouvre le feu et écrit dans le Journal de Rouen :
« Dans quelques jours doit s’ouvrir dans les galeries du premier étage du musée municipal l’exposition des œuvres d’artistes normands… Une des attractions de ce concours sera certainement l’exposition des œuvres des peintres qui se réclament de l’impressionnisme. On discutera furieusement sur la décomposition du ton et le pointillé devant à la Grande Jatte de M. Angrand et devant l’Etude au soleil de M. Lemaitre... »
Notons la participation d’Albert Lebourg. Léon-Jules
Lemaitre fait l’envoi suivant : n° 203 : "Etude au
soleil"; n°204 : "Un jardin près Rouen"; n°205 :
"Un coin du marché Saint-Marc"; n° 206 : "Un dimanche place
Saint-Godard". (18)
18) Voir le remarquable travail de Pierre Sanchez sur les
Salons et Salons de Province. Voir : Salons de Rouen, G. Bonnin, F.
Lespinasse et P. Sanchez, éd. Echelle de Jacob, Dijon, 2013.
Le numéro 204 est bien le tableau vendu le 14 décembre 2018,
en tant que "homme à la pipe assis sur une brouette dans un
jardin surplombant Rouen". Quant à l’Étude au soleil,
la localisation en est inconnue.
La presse rouennaise décortique, analyse les envois des
adeptes de Seurat. "L’Écho de Rouen", "Le Nouvelliste, "Le
Journal de Rouen" et "le Patriote de Normandie" prennent tous le
temps de rendre compte de cette salle étonnante.
Eugène Brieux,
quant à lui, écrit à Charles Angrand, le 24 octobre :
«
Mon cher Angrand, je vous écrit sous l’œil de Lemaitre avec qui je prends un
amer chez Victor. Nous causions tout à l’heure de vos toiles et des siennes.
Nous parlions aussi des compte-rendus déjà parus et nous constations qu’on ne
vous comprenait pas. Nous en avons conclu qu’il fallait expliquer à ces affreux
bourgeois ce qu’ils ne peuvent concevoir d’eux-mêmes et j’ai pensé que nul
mieux que vous ne pouvait le faire.
Nous
vous demandons donc de bien vouloir envoyer "par retour du courrier"
une longue lettre :
1°)
sur vos quatre toiles, sur les cochons et la Grande Jatte, surtout, car ce sont
les moins comprises.
2°)
sur l’Étude en plein air de Lemaitre.
Alors
et suivant vos indications : ou je publierai votre lettre elle-même et
votre signature ; ou je me servirai simplement des notes qu’elle
m’apportera en la gardant par devers moi.
Nous
vous serrons cordialement la main.
Brieux » (19).
19) Archives privées.
Charles Angrand répondit en expliquant la théorie et méthode
de Seurat ; Eugène Brieux en retour écrit le 4 novembre dans
"Le Nouvelliste de Rouen" :
« Il
est une salle parmi celles où sont exposées les œuvres envoyées au concours de
la société des Amis des Arts dans laquelle on retrouve les derniers vestiges de
la vieille gaieté française. C’est la salle où sont accrochés les tableaux de
M.M. Angrand, Lemaitre, Delattre, Frechon et Anquetin. On s’y amuse bien. On se
montre l’Etude au soleil de Lemaitre et l’on pouffe…. »
Début 1890, Eugène Noël (20) fait paraître "La
Campagne" chez Espérance Cagniard et
il a demandé à ses amis peintres rouennais d’illustrer les mois de l’année.
20) Eugène Noël (1816-1899). Journaliste, écrivain.
Bibliothécaire et conservateur de la bibliothèque municipale de Rouen.
Véritable chantre de l’écologie avec ses écrits : « Les loisirs du
Père Labêche ».
Nous retrouvons Léon-Jules Lemaitre avec son jardinier,
cette fois debout, en plein effort, annonçant le mois de novembre.
21) André Antoine (1858-1943) : Ancien employé du gaz,
comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, réalisateur et critique
dramatique français.
« Brieux est retenu
à Rouen par sa place de rédacteur en chef au Nouvelliste qui le fait vivre, il
ne peut faire souvent le voyage ; quand je suis obligé de le voir, c’est
moi qui me déplace. Donc j’arrive ce matin, sous un beau soleil, en haut de la
côte de Bon-Secours, devant une petite maisonnette qui est la sienne.
Nous dégringolons en ville faire un gentil déjeuner, et comme Brieux a
de la besogne à son journal je l’y accompagne... » (22)
22) Voir : "Mes souvenirs sur le Théâtre
Libre", Fayard, Paris,1921.
Le
24 janvier 1890, Eugène Brieux écrit à Charles Angrand :
" Mon
cher Monsieur,
Ce serait certainement marquer, pour
vos œuvres, une indifférence que je n’ai pas, que de ne pas me souvenir de
l’aimable promesse que vous m’avez faite jadis.
Je serai très heureux, le jour où je
pourrai accrocher dans mon bureau, à côté de Lemaitre et de Delattre, un
Angrand. (23)
23) Localisation actuelle inconnue.
Excusez-moi, et ne voyez dans cette
réclamation ce qu’il y a réellement : une vive sympathie pour vous et une
grande estime pour vôtre beau talent.
Eugène Brieux "
(24)
24) Archives privées.
Le 12 mars, André Antoine écrit :
« Eugène Brieux dont nous allons donner la première
pièce, "Ménages d’artistes", est un garçon mince aux
traits fins, avec des yeux bleus métalliques, une barbe et des moustaches en
pointe... » (25)
25) Ouvrage cité supra.
Puis,
le 22 mars :
« Brieux venu
à Paris pour quelques répétitions et sa première a regagné Rouen tout à fait
heureux ».
Il donne ensuite au Théâtre Français
"La fille de Duramé", drame en 5 actes, le 25 mars.
Le
lendemain, le critique du "Journal de Rouen" note :
«…le public qui s'émeut facilement
à ces horreurs a fait très bon accueil à la pièce de Monsieur Bricourt ».
Brieux poursuit
néanmoins ses activités journalistiques à Rouen, mais le théâtre prend de plus
en plus d’importance.
Il
participe aussi à l’important volume collectif de Gustave Fraipont (1849-1923),
"Les environs de Rouen" avec cent vingt dessins édités chez
Augé. Il donne deux textes : "Corneille au Petit-Couronne",
et "L’âne de Sainte-Austreberthe".
L’année
suivante, Georges Seurat meurt le 29 mars 1891. Les artistes rouennais vont
tous abandonner le divisionnisme et Lemaitre va se cantonner définitivement
dans ses vues de Rouen ; le 32ème Salon municipal de Rouen se
déroule du 10 octobre au 30 novembre ; la critique dans "Le Nouvelliste de
Rouen" est rédigée par Paul Delesques, toujours
dévoué aux artistes rouennais. Notons la présence de Delattre, Frechon,
Lemaitre. Quant à Angrand, absent, il ne reviendra au musée de Rouen qu’en
1916.
En
1892, le théâtre étant devenu pour Eugène Brieux l’élément
majeur, tout va se précipiter.
Le
10 janvier, André Antoine écrit :
« En me
promenant avec Brieux, je sens qu’il s’impatiente parce que "Bichette"
qu’il a donné à Carré ne passe pas. Il me la raconte ; Je le persuade
qu'une histoire de paysans sera beaucoup plus à sa place au Théâtre Libre, et
je lui offre de la monter tout de suite. »
Le
2 février :
« Coup double hier soir avec
"Bichette" de Brieux, devenue "Blanchette",
qui a triomphé sur toute la ligne... ».
Puis,
le 5 février :
« Le succès de
"Blanchette" a retenti jusqu’à Rouen. Aussi, Brieux m’écrit
que nous devrions aller jouer la pièce au Théâtre des Arts... ».
Le 15 février, Georges Dubosc défend son ami et confrère dans "Le Journal de Rouen". Deux jours plus tard, dans "Le Travailleur Normand" (26) est dressé dans la rubrique « Silhouettes locales » un joli et élogieux portrait : « L’auteur applaudi de Blanchette au Théâtre Libre - Le rédacteur-chef du Nouvelliste ".
26) Le Travailleur Normand : organe républicain des
cantons de Boos, Elbeuf et Grand-Couronne. Paraît de 189I à 1910.
Le
lendemain "Blanchette" est jouée au Théâtre des Arts de
Rouen par la troupe du Théâtre Libre d'Antoine, avec en lever de
rideau, "Corneille au Petit-Couronne", brillante réussite.
Le Journal de Rouen note même le 17 février : « Le
succès particulier de M. Antoine du Théâtre Libre, a été énorme auprès du
public rouennais ».
La notoriété ne va que progresser très rapidement.
Le 15 août prend fin la participation de Brieux au
"Nouvelliste de Rouen", qui disparaît ; une partie de l’équipe
de rédaction rejoint la Gazette de Rouen illustrée, une autre Le Journal de
Rouen. Le neveu d’Eugène Brieux écrit :
« Brieux arrive
chez lui, après avoir appris cette nouvelle, dansant et sautant de joie,
tant et si bien que sa femme le croit fou. Enfin il va quitter ce pays où il
s’encroutait, retourner à Paris, vivre la vie qu’il doit vivre, écrire,
arriver. Il lui semble, ce soir, que la gloire lui faisait signe par-dessus la
côte Sainte-Catherine » (27).
27) Souvenirs de Jean Courtois-Desquides, neveu d’Eugène
Brieux in Le Figaro Théâtre 31 mai 1938.
Les propos de Georges Dubosc à son confrère prennent
acte :
« Va-t'en
d’ici. Tu perds ton temps - Fais du théâtre. ». (28)
28 ) Article Journal de Rouen cité supra
Eugène Brieux quitte Rouen après
sept années, et rejoint sa ville natale pour une très brillante carrière
théâtrale. Son courageux engagement auprès des artistes rouennais marquera
brillamment et durablement aussi son passage. amis rouennais, qu'ils soient
peintres ou journalistes, ne l'oublieront pas, et continueront au contraire à
louer ses talents, comme en témoigne l'article paru – neuf ans après son
départ pour Paris – dans le numéro 173 de "L'Echo de Rouen" du 31
mars 1901 :
" Depuis
son départ de Rouen, après la fusion du "Patriote de Normandie" avec
"le Nouvelliste de Rouen", M. Brieux, abandonnant le
journalisme, encouragé d'ailleurs par le succès de "Blanchette", se
consacre entièrement à l'art dramatique, et il n'a pas à le regretter.
Doué
d'ailleurs des plus hautes qualités d'observation, ayant le sentiment de
l'action scénique et la connaissance de la langue du théâtre, sincère et
consciencieux, sachant profiter habilement, en excellent journaliste qu'il a
été, des circonstances et de l'actualité, M. Brieux a tout ce
qu'il faut pour réussir au théâtre.
Ajoutons
que M. Brieux est d'abord franc, loyal et ouvert, et qu'il a
su concilier des sympathies dans tous les partis. (…) . Signé
: M.D. "